La mort de Dennis Hopper
samedi 29 mai 2010La radio m’appelle vers 19 heures pour m’annoncer la mort de Dennis Hopper. Difficile de réagir en direct. D’abord un sentiment de grande tristesse, même si je savais par Pierre Edelman, qui était il y a trois semaines à peine au chevet de son ami Dennis, que les jours de ce dernier étaient comptés. Je dis au téléphone, en quelques minutes, tout ce qui me passe par la tête : le regard intense et amical de Dennis Hopper, sa profonde gentillesse, sa douceur et sa sincère reconnaissance lorsque nous l’avions accueilli, en octobre 2008, à la Cinémathèque française, lors de l’inauguration de l’exposition qui lui était consacrée : « Dennis Hopper et le Nouvel Hollywood ». Je me souviens de ses larmes, de son incroyable émotion lorsqu’il avait été décoré, le soir du vernissage, par Christine Albanel, alors ministre de la Culture, de l’insigne de commandeur des Arts et Lettres. Ce n’était pas grand-chose, j’ose dire le minimum que l’on devait à cet artiste, et il en était bouleversé. Pour lui et pour nous, sa vie d’acteur et de cinéaste, d’artiste et de collectionneur, de mythe de la contre-culture américaine, d’aventurier et de rebelle, tout cela prenait sens et faisait sens. Sa vie pleine de fureur et d’éclats, de luttes et de combats, souvent perdus, parfois gagnés, à travers les multiples expériences et les passages à vide (l’alcool, la drogue, les multiples descentes aux enfers), et cette capacité qu’il avait à chaque fois de renaître et de repartir à l’assaut, tout cela pour nous et pour lui prenait sens.
J’ai eu la chance, grâce à Pierre Edelman, d’aller une première fois chez Dennis Hopper, dans sa belle maison de Venice sur Indiana Avenue. C’était il y a dix ans. J’avais été impressionné par les œuvres multiples accrochées aux murs (Warhol, Rauschenberg, Basquiat, Roy Lichtenstein, Ed Ruscha, David Salle, Schnabel…) et les photographies de Dennis Hopper, par dizaines, rangées dans le désordre contre les murs. L’idée est née d’une exposition qui rendrait compte de ses multiples talents, de ses multiples vies. Celle de l’acteur légendaire (l’ami de James Dean, puis le rebelle qui osa s’affronter aux système des studios hollywoodiens), le réalisateur de Easy Rider, le film qui en 1969 ouvrit une brèche dans le système, dans laquelle s’engouffrèrent la plupart des jeunes cinéastes talentueux qui allaient prendre le pouvoir dans les années 70, le collectionneur et le photographe.
Plusieurs fois je suis revenu à Venice, avec Matthieu Orléan et Pierre Edelman. Les séances de travail se déroulaient dans le calme, Dennis nous ouvrait ses archives, nous montrait les dernières photos qu’il avait réalisées. Peu à peu l’exposition prenait son sens, et allait faire découvrir au public les multiples facettes de cet homme hors du commun. Pour le convaincre, nous l’avions invité à visiter l’exposition consacrée en 2006 à Pedro Almodovar. Elle lui avait beaucoup plu. Je lui avais présenté Nathalie Crinière, la scénographe, en lui disant qu’elle serait enchantée de travailler à nos côtés. C’est ainsi que tout a démarré. Matthieu Orléan a été le commissaire de cette exposition, Nathalie Crinière y a mis son talent. Ce dont je suis sûr, c’est que Dennis Hopper était enchanté et ému de cette expérience.
Que restera-t-il de Dennis Hopper ? Comment expliquer le fait qu’il ait été si heureux, si bouleversé, il y a à peine quelques semaines, pour ce qui fut je crois sa dernière sortie publique à Los Angeles, d’aller poser son empreinte sur Hollywood Boulevard, comme l’ont fait avant lui tant de stars du cinéma ? Peut-être parce qu’enfin, Hollywood le reconnaissait comme l’un des siens. Lui qui a passé sa vie « contre », à se rebeller contre un système économique contraignant, à imaginer d’autres voies pour vivre et travailler librement. Pourquoi voulut-il, me confie Pierre Edelman, se rendre une dernière fois à Taos avec ses enfants, Taos le lieu du repos, régénérateur spirituel, où il avait autrefois une maison, lorsqu’il fuyait Hollywood.
Pour Dennis Hopper, la forme artistique de prédilection aura été le collage. Sans doute sous l’influence d’une rencontre décisive en 1963, à Pasadena, avec Marcel Duchamp. Dans sa maison, j’avais été frappé par ce panneau : « HOTEL GREEN ENTRANCE », avec en dessous un doigt pointé vers la gauche. Un simple panneau d’indication volée dans un hôtel de Pasadena, mais signé discrètement par Duchamp et Hopper, scellant d’une certaine manière leur filiation. Dennis Hopper lui-même a réalisé de très beaux collages, dont certains furent exposés à la Cinémathèque en 2008. Mais sa vie même est un collage, un ensemble hétérogène de moments et d’événements, une somme de contraires. L’acteur mythique proche de James Dean, le rebelle de la contre-culture, le militant hippie des années 60 psychédéliques, le cinéaste (outre Easy Rider, il faut citer The Last Movie, autre film culte, Colors), l’acteur de quelques films qui resteront (Apocalypse Now, L’Ami américain, Blue Velvet…), le photographe qui s’est immergé, dès le début des années soixante, dans le milieu du Pop Art, devenant l’ami de Warhol, de Rauschenberg, de Ed Ruscha et de Raymond Pettibon, le collectionneur passionné. Ce qu’il restera de Dennis Hopper, ce sont toutes ces vies en une seule, ce mélange détonnant, en un mot ce collage.
Une citation pour terminer ce trop bref hommage. Dennis Hopper : « Un jour sur le tournage de Géant (Giant, George Stevens, 1956), James (Dean) est venu me regarder jouer dans une scène que je tournais avec Rock Hudson. L’après-midi suivant, il me dit : “ Je t’ai vu jouer ta scène. Tu étais génial. J’aurais aimé que John Barrymore soit là et puisse te voir.” J’ai commencé à avoir les larmes aux yeux, et lui : “ Si tu as besoin de pleurer au cinéma, n’oublie pas de quitter le plan. Cela sera beaucoup plus fort pour le public. Si tu pleures, sors de la pièce.” C’est ce que j’ai fait avec The Last Movie : créer de la frustration pour susciter l’émotion ». (Extrait de l’entretien avec M. Orléan, dans le catalogue de l’exposition « Dennis Hopper et le nouvel Hollywood », édité par Skira Flammarion et la Cinémathèque française).
Adieu, cher Dennis Hopper. Et permets-nous de quitter la pièce.

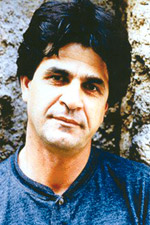 Le cinéaste iranien Jafar Panahi est sorti de prison aujourd’hui, à la suite de la décision du Tribunal de Téhéran exigeant sa mise en liberté sous caution. C’est une excellente nouvelle pour cet homme de 49 ans, qui avait commencé il y a une semaine une grève de la fin pour protester contre les conditions de sa détention. Une excellente nouvelle pour sa famille et ses proches, mais également pour tous ceux qui, depuis son arrestation le 1er mars dernier, lui avaient manifesté leur soutien.
Le cinéaste iranien Jafar Panahi est sorti de prison aujourd’hui, à la suite de la décision du Tribunal de Téhéran exigeant sa mise en liberté sous caution. C’est une excellente nouvelle pour cet homme de 49 ans, qui avait commencé il y a une semaine une grève de la fin pour protester contre les conditions de sa détention. Une excellente nouvelle pour sa famille et ses proches, mais également pour tous ceux qui, depuis son arrestation le 1er mars dernier, lui avaient manifesté leur soutien. Visuel réalisé spécialement par Marjane Satrapi pour l’événement « Une journée à Téhéran », le 13 juin à la Cinémathèque française.
Visuel réalisé spécialement par Marjane Satrapi pour l’événement « Une journée à Téhéran », le 13 juin à la Cinémathèque française.