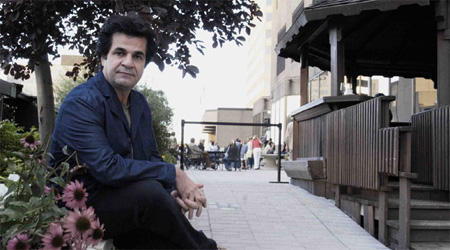Festival de Marrakech, jusqu’au 11 décembre. Dixième édition, avec un hommage au cinéma français. Bruno Barde (directeur artistique) a sélectionné 70 films qui jalonnent trois décennies, des années 80 aux années 2000. La sélection est éclectique, le survol éloquent. D’autant que la règle imposée consistait à ne choisir qu’un film par auteur. Ce sera donc Mon Oncle d’Amérique de Resnais et pas un autre. Sauve qui peut (la vie) de Godard, et pas un autre. Conte de printemps de Rohmer et pas un autre. Pialat fait figure d’exception avec deux films : Police et Van Gogh. Truffaut : Vivement dimanche !, son dernier film, alors que Le Dernier métro inaugurait mieux la décennie 80. L’Argent de Robert Bresson, réalisé en 1983, film ultime. Ce survol est à la fois totalement arbitraire, en ce sens qu’il est truffé de lacunes (aucun film de Catherine Breillat, ce qui est injuste, et l’oubli de Kechiche, une des plus fortes révélations du cinéma français de ces dernières années), tout en dessinant un chemin passionnant, divers et contrasté. Ce qu’illustre cette sélection parfois hâtive mais honnête, c’est qu’en trente ans il s’est passé bien des choses dans le cinéma français. Des générations finissent quand d’autres commencent. C’est le début de la génération Assayas, Desplechin, Carax, Claire Denis, Jacques Audiard, puis celle de François Ozon, Mathieu Kassovitz, Christophe Honoré, etc. Les grands disparus : Bresson, Truffaut, Demy, Sautet, Malle, Pialat, plus récemment Claude Berri, Chabrol ou Corneau.
Alain Corneau justement : Gregory Marouzé me demande de signaler sur mon blog la projection de son documentaire sur l’auteur de Série noire. Le titre : Alain Corneau, du noir au bleu, avec des entretiens avec le cinéaste, de nombreux extraits de ses films et images d’archives. Ce documentaire sera diffusé dans le cadre d’une nuit hommage dimanche 5 décembre prochain sur CinéCinéma Club à partir de 20h40. Ensuite, multidiffusion.
Au programme de cette soirée :
- 20h40 : Stupeur et Tremblements.
- 22h25 : Alain Corneau, du noir au bleu de Grégory Marouzé (Productions Les Films du Cyclope, CRRAV, Tribu Films, CinéCinéma, Studio Canal)
- 23h20 : France Société Anonyme.
Revenons à Marrakech. Qu’est-ce qui a changé dans le cinéma français, tout au long de ces trois décennies ? Beaucoup de chose, et d’abord le mode de financement des films. 1984 est une année importante, avec la naissance de Canal +. Le financement a basculé du côté de la télévision, processus de plus en plus tangible et visible. Le coût moyen des films a grimpé, on dit aussi que le salaire des vedettes y est pour beaucoup. Le nombre de films produits chaque année s’est développé (au-dessus de deux cents chaque année), dont beaucoup n’ont de sortie que symbolique. La loterie est donc le genre dominant, car tous les films ne sont pas logés à la même enseigne. A travers cette programmation, le fait le plus frappant est la diversité des auteurs et des genres, la coexistence de sensibilités artistiques très différentes, parfois aux antipodes. Mais c’est ainsi : le cinéma français pousse au centre, et à la marge. Et c’est la marge qui pousse le centre. Durant ces trois décennies, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont été en pleine activité, tandis qu’une génération de cinéastes renouait avec le cinéma de genre : polar, comédie sociale ou comique.
A Marrakech, la délégation française, un peu comme aux Jeux olympiques, est impressionnante, présidée par Costa-Gavras à qui ce soir Martin Scorsese a remis un prix honorifique. Le discours de Scorsese était impeccable, citant Lumière et Méliès, mais aussi Alice Guy, la génération des pionniers, puis celle des années 20 et 30, de Vigo à Renoir, en passant par Grémillon, Duvivier, Gance et Feyder, puis celle des années 50 : Ophuls, Melville, Clouzot, Tati, Bresson, Autant-Lara, puis la Nouvelle Vague (avec un coup de chapeau appuy à Alain Resnais et Mon Oncle d’Amérique, pour finir par une éloge appuyée de Costa-Gavras. Au passage, Scorsese évoque André Bazin, la Cinémathèque française, les textes critiques des Cahiers du cinéma., et l’influence profonde qu’eut le cinéma français sur la génération de cinéastes américains à laquelle il appartient.
Réunis sur la grande scène du Palais des Congrès, autour de Catherine Deneuve et Costa-Gavras : Marion Cotillard, Sophie Marceau, Jean Dujardin, Claude Brasseur, Marthe Keller, Charlotte Rampling, Stéphane Audran, Marina Hands, Vincent Perez, Alexandra Lamy, Gilles Lellouche, Pascal Elbé, Sandrine Kiberlain, Emmanuelle Seigner, Hafsia Herzi, Mélanie Doutey, Leila Bekhti, Elsa Zylberstein, Christophe Lambert, Gaspard Ulliel, Jean-Paul Rouve, Aïssa Maiga, Karine Silla, Lambert Wilson, Irène Jacob (qui est aussi membre du jury). Côté cinéastes : Agnès Varda, Jean Becker, Xavier Beauvois, Guillaume Canet, Elie Chouraqui, Bruno Dumont, Pierre Jolivet, Radu Mihaileanu, Leos Carax, Nicole Garcia, Tony Gatlif, Jean-Paul Rappeneau, Claude Miller, Danielle Thompson, Claude Zidi, Pascale Ferran, Benoît Jacquot (également au jury). Et Véronique Cayla, l’encore présidente du CNC (pour quelques jours seulement). Ce soir à Marrakech, la photo de famille du cinéma français était exceptionnelle.
Le Festival de Marrakech doit beaucoup à Daniel Toscan du Plantier, qui en a eu l’initiative il y a dix ans. Hier soir, lors de la cérémonie d’ouverture, j’avais la charge de prononcer un discours en sa mémoire, avant de remettre à Melita Toscan du Plantier un trophée que lui dédiait le festival.
« Chers Amis,
J’aimerais ce soir vous parler de Daniel Toscan du Plantier, un homme dont la passion était le cinéma. Il en parlait, en parlait, en parlait encore. Il était intarissable et il séduisait.
Au sein de la Gaumont puis comme producteur indépendant, il développa une stratégie internationale : pour lui le cinéma n’a pas de frontières. Il a produit ou financé des grands auteurs : Bergman, Fellini, Tarkovski, Kurosawa, Wajda, Losey et tant d’autres. Je l’ai croisé un jour à Calcutta où il était venu rencontrer Satyajit Ray, afin de financer un de ses derniers films : Les Branches de l’arbre (1990).
Parmi les cinéastes, il en est certains avec qui les relations furent plus fidèles – je pense à Maurice Pialat. Daniel Toscan du Plantier l’a aidé à réaliser quatre de ses films : A nos amours (1983), Police (1985), Sous le soleil de Satan (1987), puis Van Gogh (1991). Je me souviens de leur immense joie lorsque Pialat obtint la Palme d’or à Cannes en 1987 pour son adaptation du roman de Bernanos, Sous le soleil de Satan.
Il était partout à la fois, s’occupait de tout et le faisait avec talent, générosité, intelligence. Président d’Unifrance, l’organisme chargé de la promotion du cinéma français dans le monde : de 1988 à sa mort en 2003. L’Académie des César, qu’il présidait avec panache. La Cinémathèque de Toulouse, dont il était le président. Erato, la compagnie au sein de laquelle il déploya son énergie, après avoir dû quitter la Gaumont en 1985. Et bien sûr, le Festival de Marrakech, qu’il contribua à faire naître il y a dix ans, fort de l’appui et de la confiance de Sa majesté le Roi Mohammed VI. L’engagement de Daniel pour le cinéma et la caution morale qu’il apportait, ont fait que ce festival s’est développé, attirant des films du monde entier, sans que jamais la censure n’entrave son rayonnement.
J’aimerais terminer cet éloge en rappelant ce qui me semblait le plus important chez cet homme que j’ai eu la chance de connaître : Daniel Toscan du Plantier admirait les artistes et mettait toute son énergie à les défendre et à faire connaître leurs films du grand public. Le premier qu’il admira fut Roberto Rossellini, un des plus grands hommes que le cinéma mondial ait jamais connu. Daniel a passé des jours et des jours aux côtés de Rossellini, qui était l’un des pères du néo-réalisme italien. Je ne doute pas qu’il ait appris de lui certaines choses essentielles. Par exemple que le cinéma a besoin de liberté. Liberté de création, liberté de diffusion. Cette belle idée, Daniel Toscan du Plantier s’est employé à la faire vivre, à travers ce festival, dans ce beau pays qu’est le Maroc. Disparu en février 2003, Daniel Toscan du Plantier était un humaniste, un homme éclairé. C’est avec beaucoup d’émotion et d’affection que je remets à Melita Toscan du Plantier l’Etoile d’or du Festival de Marrakech ».